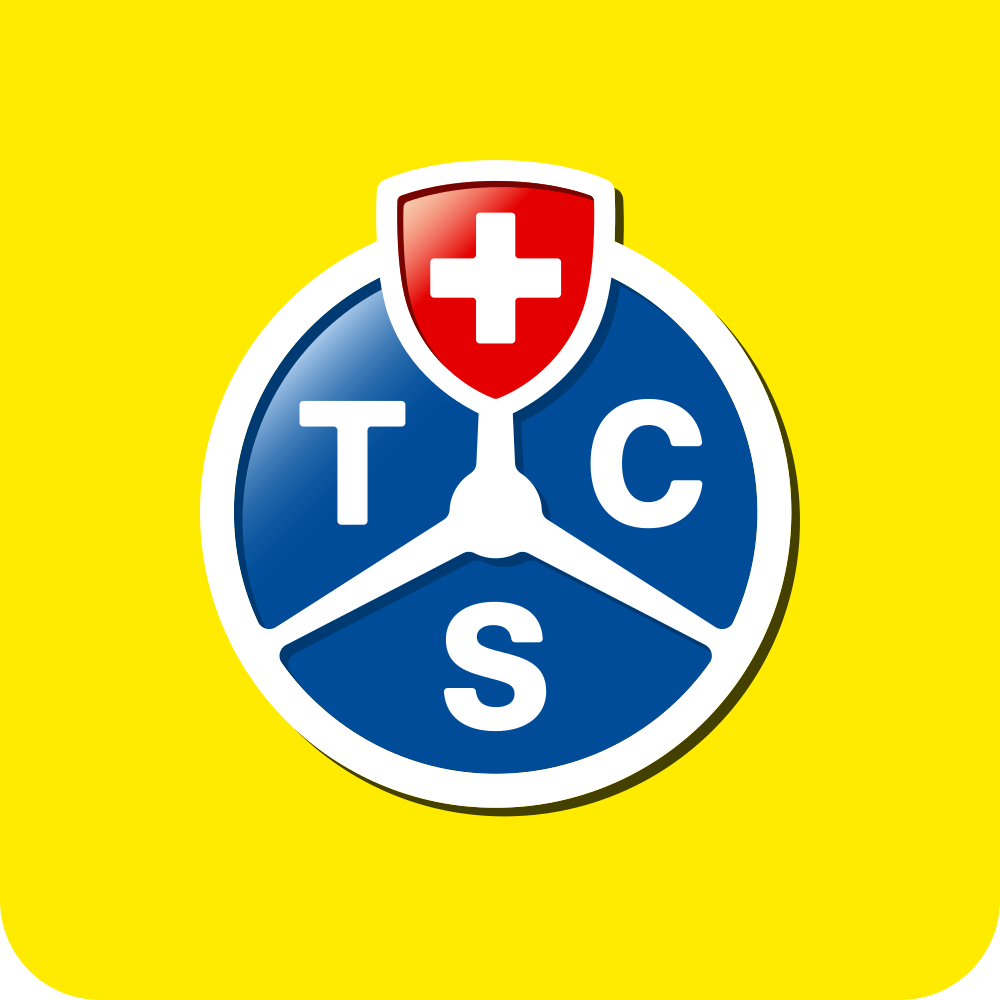Autorités
Quelle doit être la rapidité d'une procédure pénale ?

Toute personne a le droit d'obtenir du tribunal qu'il statue sur des plaintes pénales dans un délai raisonnable.
Tant la Convention européenne des droits de l'homme que la Constitution fédérale garantissent le droit à ce que les affaires pénales soient jugées dans un délai raisonnable. C'est notamment parce que le droit pénal porte fortement atteinte à la liberté personnelle que le principe de célérité revêt ici une importance plus grande qu'en droit civil. Le code de procédure pénale précise d'ailleurs ce principe de célérité en prescrivant aux autorités pénales d’engager « les procédures pénales sans délai » et de les mener « à terme sans retard injustifié ».
En cas de privation de liberté, la personne a le droit constitutionnel « d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens ». En cas de détention préventive, la personne a « le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge ». Là encore, le Code de procédure pénale précise les choses en imposant aux autorités pénales de mener « en priorité » la procédure à l'égard d'un prévenu en détention.
Le principe de célérité n'est pas absolu
Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), les autorités sont tenues de respecter le principe de célérité dès que le prévenu a connaissance de l'enquête pénale ouverte à son encontre. Le principe de célérité prend fin à la fin de la procédure de dernière instance.
Contrairement à la personne accusée, les autorités n'ont que peu de délais absolus à respecter malgré le principe de célérité. Par exemple, l'instance de recours doit rendre une décision « dans les six mois ». La cour d'appel, quant à elle, doit rendre son jugement « dans les douze mois ».
Selon le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme, dans le cas concret, la durée admissible d'une procédure pénale dépend de la complexité de la procédure, du comportement notamment de l'accusé et de l'importance de la procédure pour la personne.
La violation du principe de célérité n'est pas réglée par la loi
Ni la Constitution ni le code de procédure pénale ne règlent les conséquences du non-respect du principe de célérité par les autorités pénales. Pour le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme, le principe de célérité est par exemple violé lorsque les autorités sont restées inactives pendant une longue période. Comme l'écrit le Tribunal fédéral, le principe de célérité n'est violé que lorsqu'un manque de temps flagrant imputable à l'autorité pénale se fait jour. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'était pas admissible que l'autorité se laisse plus de trois ans pour procéder à des actes d'enquête évidents.
Si un tribunal constate une violation du principe de célérité, cela peut avoir différentes conséquences. Ainsi, cela peut conduire à une peine plus faible, voire à un verdict de culpabilité sans peine. En cas de violation massive, la personne concernée a droit à des dommages et intérêts ou à une réparation du tort moral ; en dernier recours, le classement de la procédure est également envisageable.
Mis à jour le 10 juillet 2025